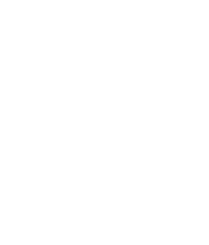Découvertes
Jusqu’au XXe siècle, l’Arabie était vue comme une terre aride au sous-sol richissime, parcourue de tout temps par des pasteurs nomades. Un paysage apparemment immuable, dont la monotonie, sous un soleil de plomb, était à peine rompue par des oasis verdoyantes (AlUla, Khaybar…), des alignements de pierres et de mystérieuses calligraphies. Des vestiges certes intrigants, mais pas de quoi déclencher des missions de fouilles. A priori…
Or, depuis 25 ans, cette région longtemps délaissée par les chercheurs est devenue un eldorado archéologique, et l’Arabie saoudite retrouve peu à peu une partie de sa mémoire préislamique.
L’impulsion, à la fin des années 1990, résulte d’un rapprochement entre universitaires français et saoudiens. Puis, en 2002, sous l’égide du ministère des Affaires étrangères français et du département des Antiquités saoudien, la première mission franco-saoudienne est créée. En 2017, le plan « Vision 2030 », lancé par les autorités saoudiennes, accélère le processus. Il inclut la valorisation du patrimoine culturel et archéologique saoudien dans le cadre d’un projet touristique ambitieux. La région d’AlUla, avec son oasis emblématique, en est la vitrine.
La France est sollicitée pour participer à l’entreprise. L’Agence française pour le développement d’AlUla (Afalula) voit le jour en 2018. Son important budget (60 millions d’euros pour 2024) lui permet de missionner plusieurs équipes du CNRS en collaboration avec leurs homologues saoudiennes. Grâce à ces moyens, les découvertes se multiplient. Et l’image de la région, longtemps décrite comme enclavée, évolue enfin.
Défendre les intérêts de l’archéologie
Cet article Arabie saoudite, le désert retrouve la mémoire est paru initialement sur CNRS News National.
Lire en entier