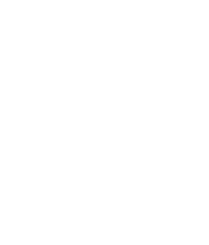Entretien avec le philosophe Bernard Stiegler.
Commençons par un peu d’histoire. En 1987, vous étiez commissaire de l’exposition « Mémoires du futur », au centre Pompidou, à Paris. Quel en était le principe ?
Bernard Stiegler : À l’époque, je travaillais au Collège international de philosophie, où je donnais un séminaire autour de mes réflexions d’alors sur les rapports entre la mémoire humaine et la technique. Un colloque s’est ensuivi, au château de Vincennes. En pleine préparation du dixième anniversaire de l’établissement, Jean Maheu, le président du centre Pompidou m’a ensuite proposé d’organiser une exposition sur ce que serait la culture du XXIe siècle. Avec Catherine Counot, de la Bibliothèque publique d’information, nous nous sommes attachés à figurer l’avenir des bibliothèques dans un contexte où j’étais convaincu que la mémoire collective allait devenir l’enjeu central du développement industriel. Ni moi ni personne ne savait ce que serait la bibliothèque du XXIe siècle. J’ai donc proposé de montrer ce que je souhaitais qu’elle soit.
Pendant plus de deux ans, nous avons travaillé avec des historiens, des archéologues, des informaticiens, des spécialistes des bibliothèques et de la « documentique »… C’était le début des bases de données, et le succès en France de la télématique.
L’exposition, tout en jouant sur une mise en perspective où l’on remontait le temps, mettait en regard le temps réel et le temps différé : d’un côté, des téléscripteurs de l’AFP et leur flot de dépêches, des chaînes de télévision du monde entier… ; de l’autre, les premiers CD-Rom, le Trésor de la langue française informatisé, qui était une production du CNRS, les archives de l’INA, notamment.
L’INA était associé à un atelier au sein duquel les visiteurs pouvaient s’inscrire pour apprendre à monter des images – avec de prestigieux formateurs, tel Serge Daney. Après une journée de formation, et l’étude des journaux télévisés de la veille (à cette époque, 30 chaînes de télévision étaient accessibles en France), les participants pouvaient construire des « contre-journaux télévisés » en s’appuyant en particulier sur les archives de l’INA et les bases de données. Les résultats étaient souvent saisissants !
Dans d’autres ateliers, où intervenaient des écrivains, on apprenait à interpréter les dépêches de l’AFP avec un logiciel d’aide à l’écriture dans les styles de Zola, de Flaubert… inspiré des travaux de l’Oulipo. Dans un troisième, on pratiquait la recherche documentaire avancée pour tous.
Nous posions ainsi que l’avenir était aux réseaux, et que le XXIe siècle verrait s’en développer les pratiques instrumentées les plus inattendues. Nous voulions en outre affirmer qu’une société est constituée par sa mémoire, et que cette mémoire doit être vivante – son industrialisation pouvant à cet égard induire quelques questions : comment en effet imaginer l’avenir du savoir dans une société qui transforme tout en information ?
Quelle différence faites-vous entre savoir et information ?
Le savoir est une transformation de l’information. Celle-ci perd de la valeur avec le temps. De fait, la valeur d’une dépêche d’actualité s’évapore du jour au lendemain. Du point de vue de la théorie de l’information, cette valeur est calculable à partir d’un modèle entropique selon lequel plus l’information diffuse, moins elle informe.
À l’inverse, le savoir est cumulatif, et, en cela, néguentropique : il ne perd pas sa valeur et, tout au contraire, il s’enrichit avec le temps. Albert Einstein ne rend pas Isaac Newton obsolète : il le réinterprète. Il faut étudier Newton pour étudier Einstein. Tous les savants sont de tels « nains sur des épaules de géants », et tous les domaines du savoir sont plus ou moins cumulatifs – y compris le football, la cuisine, la maçonnerie et le jeu d’échecs…
Avec l’exposition « Mémoires du futur », nous annoncions que le XXIe siècle serait celui de la mémoire et de son exploitation par des moyens technologiques et industriels, mais aussi des menaces qu’il pouvait y avoir à la réduire à de l’information. Le défi était alors – et est toujours – d’empêcher que l’information ne détruise le savoir, et avec lui, la société. Pour ce faire, l’éducation doit être réinventée de A à Z, du Collège de France à la maternelle, et de façon à faire des citoyens des connaisseurs de ces technologies, qu’ils en soient des praticiens, et non des esclaves, ni même de simples « utilisateurs » en réalité consommateurs. Pour le moment, c’est très mal parti…
Vous différenciez également l’avenir et le devenir. De quelle façon ?
Pour répondre, voyons ce qui distingue d’une part le vivant du non vivant, et d’autre part les êtres humains des autres êtres vivants. Une table n’a pas de besoin particulier à assouvir : elle n’a pas à se nourrir par exemple – à l’inverse du moindre asticot. Sans garantie d’être encore vivant demain, ce minuscule être vivant est emporté à court terme par le devenir entropique de l’Univers. Si la table peut conserver sa structure à beaucoup plus long terme, elle n’a pas à maintenir sa structure en se nourrissant, cependant que table et asticot sont tous deux inéluctablement pris dans l’augmentation de l’entropie, c’est-à-dire du désordre.
Avec l’apparition au XVIIIe siècle du concept d’entropie, la question de l’instabilité fondamentale de l’Univers en totalité fut tout à coup posée. Ce bouleversement aura été un choc énorme, qui n’est d’ailleurs toujours pas surmonté aujourd’hui – ni par les physiciens, ni par les philosophes. On sait désormais que l’Univers va vers un refroidissement généralisé.
Caractérisé par sa lutte contre l’entropie, tout être vivant inscrit dans le devenir une bifurcation qui constitue son avenir
Cependant, depuis les travaux d’Erwin Schrödinger, tout être vivant est caractérisé par sa capacité à lutter contre ce devenir, contre cette augmentation de l’entropie : il a un avenir, qu’il inscrit dans le devenir, et, en provoquant ce que la théorie des systèmes appelle une bifurcation, il peut « remonter le courant » de l’entropie, et produire localement un ordre au lieu d’un désordre. Schrödinger parlait en cela d’entropie négative, ou néguentropie.
Qu’en est-il des êtres humains ?
Ce ne sont pas seulement des êtres vivants : regardez Stephen Hawking, un être biologiquement non-viable, et néanmoins considéré comme l’un des personnages les plus importants de la physique contemporaine. Il « était » à travers ce qui n’était pas vivant. Pour le comprendre, il faut mobiliser un concept qui a été formulé par Alfred Lotka. Ce mathématicien et statisticien est surtout connu pour les équations dites de Lotka-Volterra concernant la dynamique des populations, mais le plus important est ce qu’il publie en 1945 : il pose alors que les êtres humains sont essentiellement dotés d’organes exosomatiques, en premier lieu les outils. Ils ont bien des organes endosomatiques (des yeux, des oreilles…), mais les plus importants sont exosomatiques.
L’anthropologue André Leroi-Gourhan avançait ce genre d’idées en tentant de ne pas se fâcher avec le point de vue darwinien dominant. Lotka est plus direct. Selon lui, l’évolution humaine est avant tout exosomatique et donc orthogénétique. En d’autres termes, elle peut échapper à la sélection naturelle, et cette vision rompt avec une compréhension darwinienne de l’être humain.
La rupture entre l’animalité et l’humanité relève de ce que les Grecs appelaient la noèsis, c’est-à-dire la capacité à penser, à faire une démonstration, à raisonner, à prendre une décision… L’asticot ne décide de rien, il essaie de vivre en étant mu par les instincts inscrits dans son patrimoine génétique et ses relations avec l’environnement. Nous, en principe, nous avons des facultés de décision, ce qu’on appelle la liberté : nous pouvons créer des bifurcations délibérées.
Et nous devons délibérer pour une raison que Lotka explique très bien : si les organes naturels de l’asticot sont spontanément et intégralement mis en œuvre et organisés pour lutter contre l’entropie, ce n’est pas le cas des humains. Dans cet article paru au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Lotka affirme que les organes (exosomatiques) que produit l’homme sont aussi destructeurs que constructeurs. C’est pourquoi la délibération est impérativement requise.
Et, justement, la mémoire est externalisée dans des organes exosomatiques ?
Dès le début, il y a trois millions d’années, et pour ce qui concerne la mémoire sensorimotrice. Mais il y a au moins quarante mille ans et sans doute beaucoup plus, l’humanité procède à une externalisation de sa mémoire mentale dont les grottes témoignent. La mémoire sensorimotrice de l’être humain se transmet à travers les outils cependant qu’à partir du Paléolithique supérieur ce sont les contenus mentaux eux-mêmes qui sont transmis. Une orthogenèse s’opère alors par la sélection des individus qui ont les meilleurs organes artificiels, et les meilleures capacités à les produire et à les utiliser.
La mémoire de l’homme n’est pas dans son corps, ni donc dans son cerveau : elle est dans ses productions. Or, aujourd’hui, l’humanité produit sans cesse plus vite de nouveaux organes sans parvenir à élaborer les savoirs nécessaires à leur pratique.
C’est ce que vous appelez la disruption ? On perd le contrôle de notre mémoire de plus en plus externalisée ?
Ce mouvement très complexe étant assez récent, nous manquons de recul pour l’appréhender. Le principal argument de l’exposition « Mémoires du futur » était que ces technologies doivent être prises en charge par une politique repensée en fonction de ce qu’elles portent de nouveau qui ne doit pas être abandonné aux lois du marché et des actionnaires. Je soutiens dans Qu’appelle-t-on panser ? que c’est l’enjeu de ce que Nietzsche appelle une politique de la mémoire.
Les plateformes via nos smartphones créent de la dépendance en prenant le contrôle de nos mémoires. Une pédopsychiatre avec qui je travaille en Seine-Saint-Denis tente de prendre soin de jeunes mères qui calment leurs nouveau-nés avec leurs smartphones. Deux ans ou trois ans plus tard, les bébés ont tous les symptômes de l’autisme. La disruption qui prend de vitesse les organisations sociales ruine ainsi les savoirs les plus élémentaires.
Est-ce une stratégie délibérée par la Silicon Valley ? Et dans quel but ?
C’est évidemment une expression de la « volonté de puissance », où la question est la place du calcul : dans la Silicon Valley, on pense que le calcul peut tout résoudre. Or c’est absolument faux : les bifurcations néguentropiques ne sont jamais calculables par les systèmes.
À l’inverse, cette accélération en quoi consiste la disruption nous précipite vers une augmentation de l’entropie à une échelle incommensurable, ce qui se révèle dans le dérèglement climatique et tout ce que le terme d’anthropocène recouvre plus largement – et qu’il faudrait appeler l’Entropocène.
Que faire ?
D’abord se souvenir qu’il y a toujours de l’improbable et que tout n’est pas calculable. Ensuite contribuer à générer des bifurcations positives, et nous nous y employons en Seine-Saint-Denis, sur un territoire où résident 430 000 habitants, en partenariat avec Plaine Commune, la Fondation de France, Orange, Dassault, la Caisse des dépôts, la Société générale, le Crédit du Nord, Danone et l’Afnic.
Nous travaillons au développement d’une économie organisée avant tout en vue de combattre l’entropie. Le point de départ est l’étude de l’université d’Oxford affirmant en 2013 que 47 % des emplois aux États-Unis sont automatisables. Ils le sont parce que ce sont des emplois prolétarisés, c’est-à-dire occupés par des employés obéissant au système, tâche pour laquelle les algorithmes et robots seront de plus en plus efficaces : ils occuperont ces emplois.
Toute l’histoire de la connaissance est conditionnée par les organes exosomatiques produits par l’homme depuis trois millions d’années
La prolétarisation telle que l’ont décrite Adam Smith puis Karl Marx repose sur le transfert du savoir du travailleur vers la machine, qui se soumet ainsi à ce travailleur se retrouvant privé de ce savoir et de la mémoire. À présent que les prolétaires peuvent être remplacés par des robots ou des algorithmes, comment à la fois rendre du pouvoir d’achat à ceux qui n’ont plus d’emploi et lutter contre l’entropie générée par les systèmes fermés que sont les systèmes automatisés ? La réalité de l’anthropocène, c’est l’augmentation de l’entropie thermodynamique, de l’entropie biologique et de l’entropie informationnelle. L’économie de demain sera nécessairement une économie de lutte contre l’entropie.
Pour ces êtres exosomatiques que sont les humains, le seul moyen d’y parvenir est le savoir : c’est ce que montre Lotka. Quel qu’il soit – celui du cuisinier, du sportif, du mathématicien, du juriste, du philosophe, du physicien – seul un savoir est capable d’introduire dans le monde quelque chose qui n’y était pas et qui réduit l’entropie. Le savoir n’est pas automatisable : il dépasse toujours tout calcul (on parle de créativité). Valoriser la lutte contre l’entropie suppose de redonner alors de la valeur au local. D’ailleurs, Schrödinger explique pourquoi la néguentropie est toujours locale.
Puisque l’on parle de demain, quels liens entretient la mémoire avec le futur ?
Elle est toujours orientée vers le futur. Le philosophe allemand Edmund Husserl, marqué à la fois par saint Augustin et David Hume, a montré que la conscience humaine est constituée de rétentions et de protentions dont l’agencement constitue l’étoffe du temps vécu. Les rétentions sont ce qui est retenu, constituant le passé, les protentions sont ce qui est projeté à partir de ce qui est retenu, constituant le futur. Mais il montre que le présent est lui aussi constitué de rétentions, qu’il appelle « primaires », pour les distinguer des rétentions du passé, qu’il appelle « secondaires ». Car lorsque je perçois quelque chose qui est présent, par exemple un paysage que je parcours des yeux, je retiens « primairement » ce que j’ai perçu précédemment dans ce que je perçois actuellement, et par où le paysage m’apparaît – comme dans ce que l’on appelle au cinéma un « panoramique ». Primairement signifie ici : retenu dans et par le présent, par où cela se présente.
Ces rétentions primaires sont-elles comparables à la mémoire de travail ?
Certains neurologues confondent les deux, mais les rétentions primaires sont autre chose que la mémoire de travail, qui est un stockage temporaire. L’enjeu est ici de bien comprendre les rapports entre rétentions primaires et rétentions secondaires. Supposons que vingt personnes écoutent ce que j’ai dit depuis le début de notre entretien, et que nous demandions à présent à ces vingt personnes de redire ce que j’ai dit : nous aurons vingt versions différentes, et sans doute très différentes. Il en va ainsi parce que chaque personne entend ce que j’ai dit en fonction de son passé et des expériences au cours desquelles il s’est élaboré, ce qui veut dire que les rétentions primaires sont aussi et d’abord des sélections primaires, dans ce que j’ai dit, de ce qui intéresse ceux qui m’écoutent, leurs rétentions secondaires constituant les critères à partir desquels sont sélectionnées les rétentions primaires.
Sur ces bases s’opèrent des anticipations que Husserl appelle des protentions, et ces protentions engagent elles-mêmes des actions. Cependant il faut ici introduire un élément supplémentaire, que Husserl évoque à la toute fin de sa vie, et que j’ai moi-même appelé la rétention tertiaire. Si les Égyptiens ont pu exploiter le Nil, c’est grâce aux rétentions tertiaires que constituent les systèmes d’écriture et de numération apparus après le néolithique. Les rétentions secondaires mises sous forme écrite sont des rétentions tertiaires accessibles non seulement à l’individu qui les a vécues, mais à ses successeurs : nous. Ainsi, en accumulant sur le temps long des notations sur les mouvements des étoiles qui ont établi le calendrier égyptien et sur les crues du Nil, les Égyptiens ont pu exploiter le fleuve et gérer un vaste système d’irrigation. C’est ainsi qu’est née cette civilisation.
On retrouve à nouveau l’externalisation de la mémoire ?
En effet, et la mémoire humaine est intégralement conditionnée par la rétention tertiaire. C’est vrai des peintures de Lascaux, du silex taillé par nos ancêtres, de nos agendas et de nos smartphones, services GPS, systèmes d’intelligence artificielle… – la data economy étant une économie industrielle des rétentions tertiaires numérisées et calculables. Des silex taillés aux smartphones en passant par l’écriture alphabétique, toute l’histoire de la connaissance est conditionnée par ces procédés d’externalisation. Cela ne veut pas dire qu’elle y est réductible. Mais sans elle, la transmission de savoir n’aurait jamais pu se produire
Y a-t-il des ruptures dans l’histoire des rétentions tertiaires, et donc de notre mémoire ?
Évidemment. Cependant, une rupture se fait toujours sur un fond de continuité, elle est toujours relative. Après le Paléolithique supérieur et les peintures rupestres, il y a eu celle, majeure, du Néolithique. La sédentarisation s’est accompagnée d’une augmentation de l’accumulation des rétentions tertiaires et de leur gestion raisonnée. Ainsi se sont formés les empires en Chine, en Mésopotamie, en Égypte, plus tard en Amérique latine.
C’est ansi que sont apparues les formes idéographiques d’écriture. Puis, en passant par l’écriture cunéiforme, est apparu l’alphabet. À présent l’alphabet a été intégré dans le codage alphanumérique de ce que Clarisse Herrenschmidt a appelé l’écriture réticulaire, qui passe par des machines. Tout cela a engendré une série de ruptures sur fond de continuité. La continuité, c’est l’exosomatisation. Les ruptures, ce sont les nouvelles organisations sociales requises par les nouveaux organes exosomatiques.
À chaque fois que la mémoire est transformée par les techniques artificielles de mémorisation, c’est le rapport au temps qui change. Ce rapport au temps, qui n’est déterminé ni par notre cerveau, ni par les lois de la physique, est conditionné par ces dispositifs de mémorisation que forment les rétentions tertiaires.
Le problème propre à notre temps – et c’est ce que voyait déjà venir Lotka en 1945 – est que les technologies se substituent aux organisations sociales elles-mêmes, et, ce faisant, détruisent les savoirs, c’est-à-dire les capacités à faire que les organes artificiels produisent plus de néguentropie que d’entropie. Tel est l’enjeu de l’Anthropocène, et de ce que nous tentons de faire avec Plaine Commune pour le dépasser.